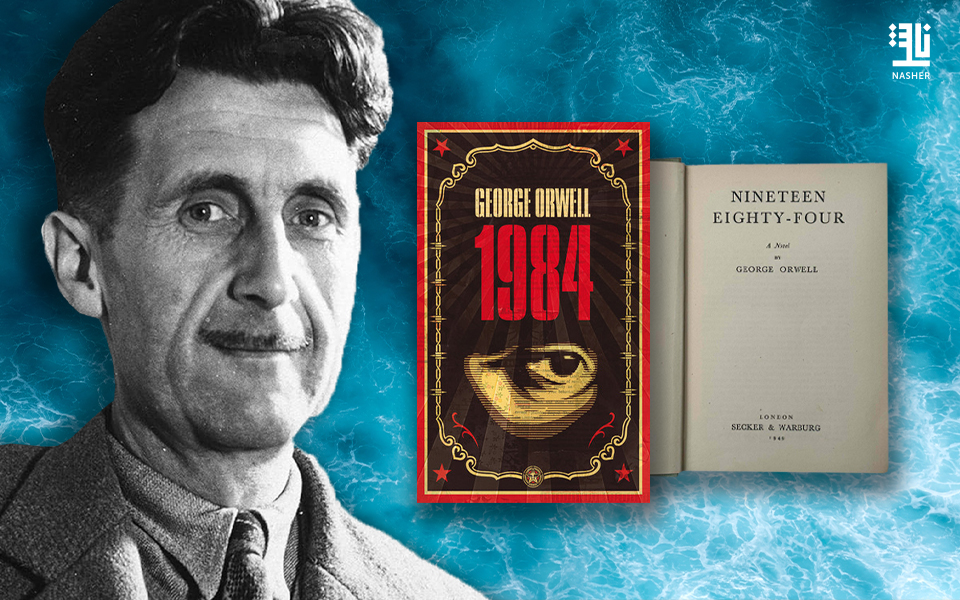En août 1947, alors qu’il rédige 1984 sur l’île écossaise de Jura, George Orwell échappe de peu à la noyade. Mal renseigné sur les marées, il dirige par erreur son embarcation vers les remous du redouté maelström de Corryvreckan. Le bateau chavire. Orwell, son fils, son neveu et sa nièce sont précipités dans l’eau. Il note l’accident dans son journal avec une froideur troublante : « Sur le chemin du retour, nous avons été pris dans le tourbillon et avons failli nous noyer. » Cette distance, typique d’Orwell, pourrait masquer un traumatisme durable.
Dans 1984, l’eau semble imprégner les cauchemars : naufrages, submersions, noyades hantent la narration. Winston Smith rêve de sa mère et de sa sœur prisonnières dans un salon de paquebot englouti, image d’une culpabilité profonde liée à l’enfance. Le roman s’ouvre sur une attaque de réfugiés en mer, et la menace d’une noyade dans la Chambre 101 pèse comme torture ultime. L’eau n’est pas qu’un décor : elle est mémoire, punition, effroi. Elle agit comme une allégorie de la perte de repères et de l’engloutissement moral dans l’univers d’Océania.
Cette obsession remonte à plus loin. Adolescent, Orwell fut bouleversé par le naufrage du Titanic, bien plus que par les horreurs de la guerre. Dans Gardez l’aspidistra en vie (Keep the Aspidistra Flying, 1936), l’image d’un paquebot sombrant symbolise la chute de la civilisation moderne. De 1984 à ses essais comme Mon pays à tort ou à raison (My Country Right or Left, 1940), les références maritimes jalonnent son œuvre. Si rien ne prouve que 1984 est une réponse au Titanic ou à Corryvreckan, la mer agit comme fil rouge, liant ses angoisses d’enfant, ses blessures d’adulte et ses visions d’un monde au bord du naufrage.